La future installation de stockage, qui accueillera les déchets radioactifs de faible et moyenne activité et de courte durée de vie, et ses environs feront l’objet d’un contrôle permanent pendant 350 ans. Mais comment évaluons-nous la sûreté sur plusieurs centaines, voire plusieurs milliers d’années ?

Grâce notamment à l’analyse des scénarios d’évolution et aux modèles informatiques, nous sommes en mesure de montrer que l’installation reste sûre sur une telle échéance. Les explications d’Elise Vermariën.
Comment est conçue la sûreté de l’installation ?
Elise : « La future installation de stockage qui accueillera les déchets radioactifs de faible et moyenne activité et de courte durée de vie est conçue pour être sûre et fiable, aussi bien pendant la période opérationnelle qu’à long terme.
Les déchets y seront stockés dans des modules en béton construits en surface. Ces modules seront protégés par une couverture permanente de plus de 5 mètres faite notamment de terre, de sable, de gravier, d’argile et de béton. Sa fonction ? Préserver les barrières ouvragées situées en dessous contre les conditions extérieures (climat, infiltration d’eau, intrusion humaine, ...).
La couverture et les autres barrières ouvragées isoleront les déchets de l’Homme et l’environnement et confineront les substances radioactives. »

Un contrôle actif est prévu pendant 350 ans
Elise : « L'installation de stockage et ses alentours feront l’objet d’un contrôle permanent pendant 350 ans. Plusieurs aspects seront contrôlés, par exemple l'impact radiologique sur l'environnement (air, sol, eau) et une éventuelle contamination radiologique. Les performances de l’installation même seront aussi contrôlées jusqu’ à sa fermeture, c’est-à-dire après 100 ans, les modules seront équipés d’espaces d’inspection qui permettront notamment de déceler à temps les éventuelles fissures ou infiltrations d’eau et d’y remédier. La couverture sera également inspectée régulièrement. »
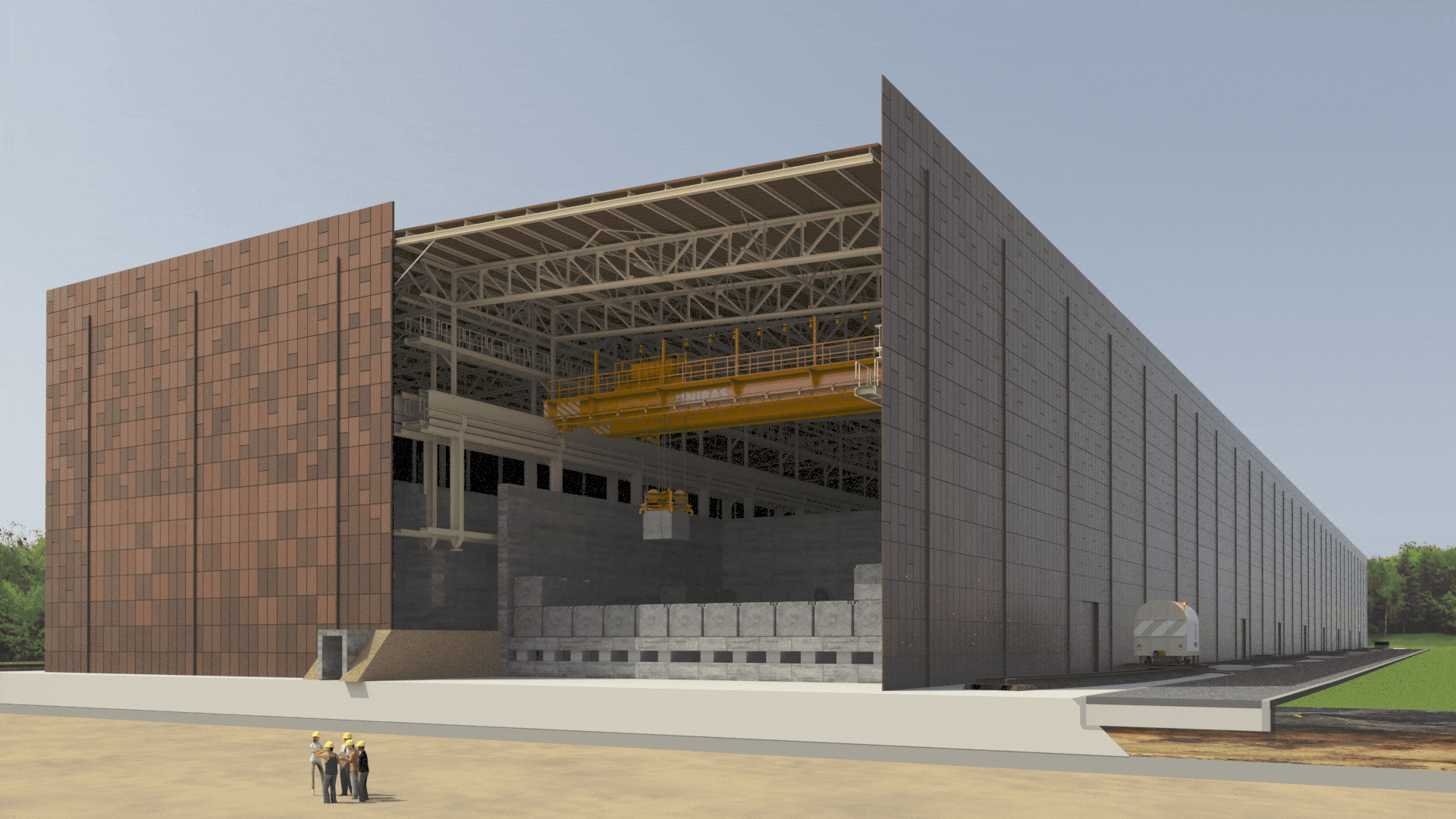
Et après 350 ans ?
Elise: « Garantir et démontrer la sûreté à long terme de l’installation de stockage en surface ne s’arrête pas à 350 ans, moment où le contrôle actif sera levé. Les radionucléides de courte durée de vie présents dans les déchets perdront la majeure partie de leur radioactivité au cours de cette période de contrôle de 350 ans. Ce n’est pas le cas des radionucléides de longue durée de vie qui resteront radioactifs pendant plusieurs milliers d’années, voire plus. Or, ces radionucléides peuvent être présents en très faibles quantités dans les déchets qui seront stockés.
Afin de garantir la sûreté de l’installation sur le très long terme, nous devons savoir comment les barrières ouvragées comme le béton ou la couverture vont évoluer sur plusieurs centaines, voire plusieurs milliers d’années. Quels sont les événements et perturbations qui pourraient entraîner une dégradation de ces barrières et à terme, un relâchement de ces radionucléides dans l’environnement ? Quelle est la probabilité que ces évènements et perturbations se produisent, à quelle intensité et à quelle période du cycle de vie de l’installation ? Et avec quels effets radiologiques pour l’Homme et son environnement ? »
Comment procédons-nous ?
Une description détaillée
Elise : « Nous avons tout d'abord réalisé une description détaillée, scientifiquement fondée, de l'évolution attendue de l’installation de stockage, notamment sur la base de nos programmes de recherche, développement et démonstration (RD&D). Mais le degré de confiance vis-à-vis de cette description diminue avec le temps. En effet, après environ mille ans, les incertitudes tendent à augmenter et l’installation se dégradera progressivement. Même dans ces circonstances, l’installation confinera encore la vaste majorité de la radioactivité résiduelle. D’autres évolutions, liées à des perturbations non attendues mais possibles, pourraient également se produire. »
Des scénarios d’évolution
Elise : « Dans nos évaluations de sûreté à long terme, nous nous servons ensuite de différents scénarios qui décrivent chacun une évolution possible ou hypothétique de l’installation et de son environnement. Le scénario d’évolution attendue constitue le scénario de base. Des scénarios d’évolution alternative décrivent les effets des perturbations non attendues mais possibles. Dans ce type de scénario, l’installation de stockage se dégrade plus vite, plus tôt ou plus gravement que prévu. Que se passerait-il, par exemple, en cas de tremblement de terre de forte magnitude ?
Nous avons également étudié les scénarios d’intrusion humaine. Que se passerait-il si quelqu’un pénétrait involontairement dans l’installation de stockage après la levée du contrôle ? Il pourrait y avoir une exposition radiologique pour l'intrus, pour la population proche et pour l’environnement.
Enfin, nous avons étudié les scénarios « pénalisants » : après quelques milliers d'années, les incertitudes sont telles que nous partons du principe que le confinement et l'isolation du stockage sont minimes. »

Des modèles informatiques
Elise : « En coopération avec le centre de recherche nucléaire SCK CEN, nous développons ensuite des modèles informatiques qui simulent le comportement de l’installation de stockage à très long terme en fonction des différents scénarios d’évolution et en tenant compte du comportement des barrières principales. Ceci nous permet de confirmer que le niveau de confinement et d’isolation assuré par l’installation reste proportionné aux risques que présentent les déchets. Pour estimer les effets radiologiques possibles, il existe aussi des modèles permettant de simuler la migration des radionucléides dans les eaux souterraines, puis dans l'environnement.
Grâce à nos modèles, nous calculons des indicateurs dont le plus important est la dose radiologique à laquelle l’Homme et l’environnement seraient exposés pour tous les scénarios d’évolution envisagés. Nous étudions actuellement trois groupes d'âge : les adultes, les enfants d'environ 10 ans et les tout-petits qui sont sensibles à des radiations spécifiques et pourraient subir des effets plus importants. Grâce à des modèles établis par la communauté internationale, nous calculons également la dose de radioactivité pour la faune et la flore environnantes. »
Quelle est la conclusion ?
Elise : « Dans les différents scénarios étudiés, les effets radiologiques à long terme respectent les critères imposés par l’autorité de sûreté belge. Les calculs indiquent donc que le stockage est aussi sûr à long terme. Les évaluations de sûreté présentent une double fonction : elle nous permettent à la fois de démontrer que l’installation est sûre sur le long terme et d’imposer en amont des critères pour les déchets et les barrières ouvragées que nous allons vérifier avec précision pour démontrer que nous pouvons être confiants quant à la sûreté de l’installation. »
